Herbier du lieutenant Boëry
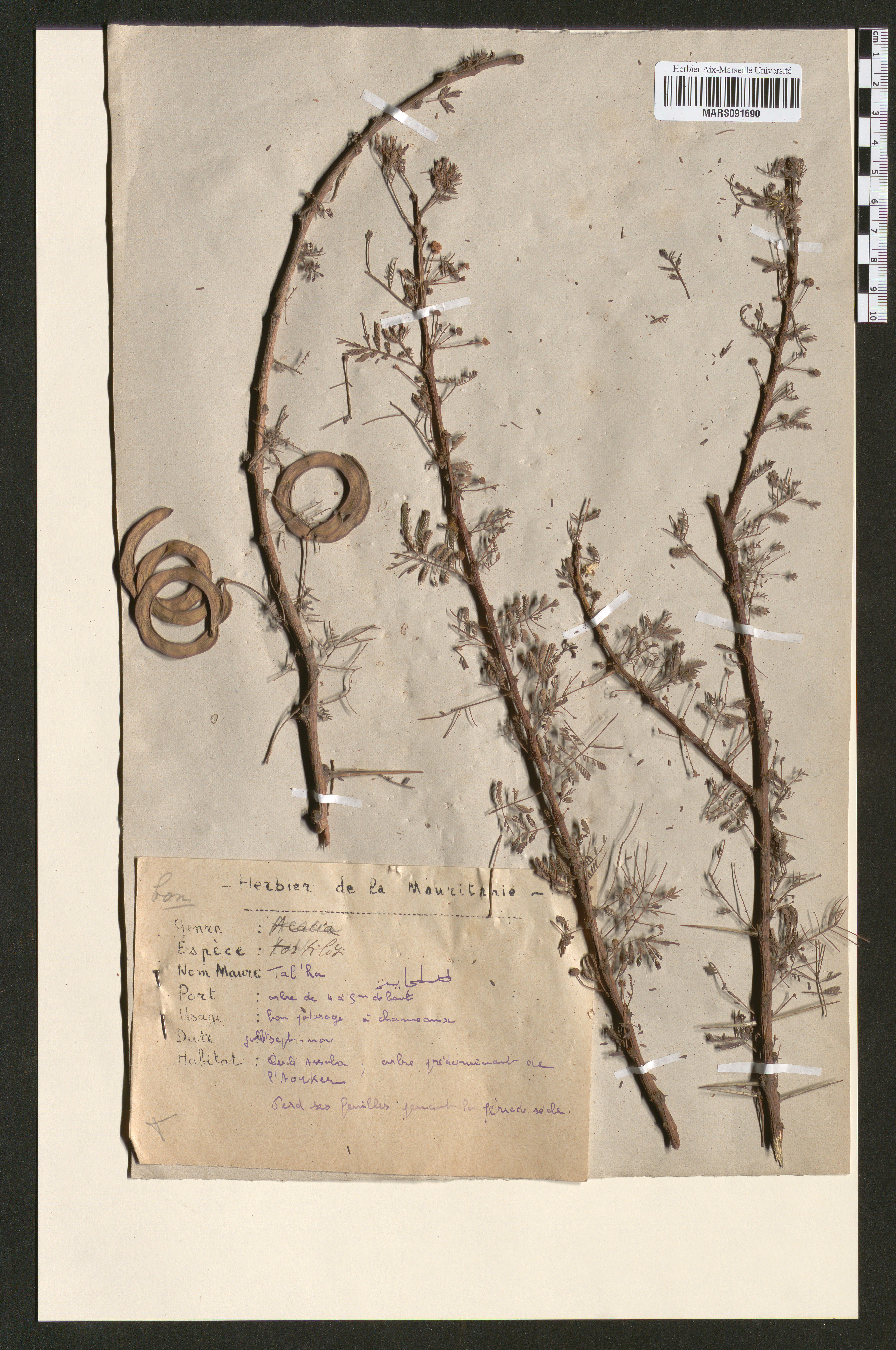
Mauritanie et du Soudan Français du Lieutenant Boëry comprenant 182 parts récoltées entre 1926 et 1930. Chaque part porte une étique avec les informations relatives à la récolte de chaque échantillon.
Échantillon botanique, 1926 - 1930, Faculté des Sciences - Université d'Aix-Marseille, Faculté des Sciences - Université d'Aix-Marseille, Herbiers de l'ancien musée colonial de Marseille
Constitution de l’herbier
Les plantes constituant l’herbier de Mauritanie ont été récoltées par Pierre Boëry, lieutenant de l’infanterie coloniale lorsqu’il était en poste à Kiffa (Mauritanie) de 1924 à 1926 puis à Néma (Soudan Français) de 1928 à 1930. Ces zones d’Afrique sub-saharienne, alors territoires de l’Afrique Occidentale Française, présentent des profils climatiques et géographiques très proches. Pierre Boëry a récolté un total de 182 plantes constituant un herbier de 238 échantillons qui correspondent à 44 familles, 103 genres et 149 espèces. La majorité des récoltes date du premier séjour de Pierre Boëry en 1925 et 1926. Outre la date de collecte et les noms de genre et d’espèce, les étiquettes comportent aussi le nom maure et des informations sur le port et les usages des plantes. À l’exception des informations relatives à la détermination botanique complétées par Jumelle, les différents champs ont été remplis sur place par le lieutenant Boëry.
Interprétation scientifique de l’herbier
L’analyse de l’herbier est publiée par Henri Jumelle sous la forme de 2 articles successifs qui paraissent dans les Annales du musée colonial de Marseille en 1928 et 1931. Le premier article concerne la description de la végétation de la région de Kiffa, chef-lieu du cercle de l’Assaba et couvre, outre les massifs de l’Assaba, de l’Affollé, et du Rkiss, la dépression du Regueiba. Reprenant les notes manuscrites de Boëry en sa possession, Jumelle indique que la flore de la région de Kiffa correspond à la transition entre la flore désertique et la flore soudanienne. Après avoir cité les groupements observés d’après les caractères du terrain dans la région, il énumère les plantes récoltées par le lieutenant de l’infanterie coloniale. Dans le second article, Jumelle poursuit l’énumération des plantes récoltées et leur analyse, qu’il aborde d’un point de vue strictement floristique et biogéographique. Les plantes décrites proviennent de la zone sahélienne du Soudan français, plus sèche encore que celle de Kiffa. Un certain nombre d’espèces sont cependant communes à ces deux contrées, administrativement distinctes, mais appartenant toutes deux à la même zone subdésertique.
Un herbier à vocation scientifique et militaire
Pour environ la moitié des plantes récoltées, Boëry indique leur usage par les populations locales, mais les indications les plus fréquentes concernent le caractère comestible ou non de la plante pour le chameau. Ce renseignement particulier illustre l’importance primordiale du chameau dans l’organisation administrative et militaire de cette partie de l’Afrique Occidentale Française. Seuls la possession et l’entretien d’un cheptel abondant permettaient de contrôler les différentes tribus nomades de ces régions. Ainsi, si les articles d’Henri Jumelle mettent bien en lumière l’apport scientifique de l’œuvre de Boëry pour la connaissance de la flore sahélienne, l’analyse détaillée du texte des étiquettes permet de voir que la collecte du lieutenant Boëry répondait aussi aux préoccupations des officiers méharistes soucieux de l’entretien de leurs montures.
Exposition
L’herbier du lieutenant Boëry intègre les collections du Musée colonial et vient compléter les herbiers de Madagascar, de la Réunion, des Antilles, ou encore de la Nouvelle-Calédonie. Au moment de l’arrivée de cet herbier, à la fin des années 1930, c’est Henri Jumelle qui était le directeur du Musée colonial de Marseille.
Auteurs et autrices
-

VILA Bruno
Écologue, LPED
Pour citer
(2024). “Herbier du lieutenant Boëry”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/herbier-du-lieutenant-boery), page consultée le 30 novembre 2024, RIS, BibTeX.